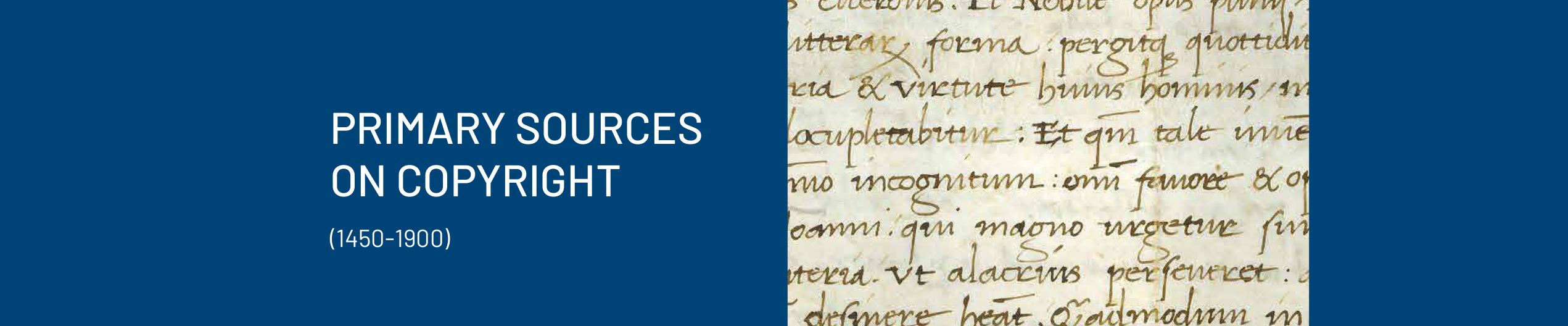Sieur d'Anville's contract (1759)
Back | Commentary info | Commentary
Printer friendly version

This work by www.copyrighthistory.org is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Primary Sources on Copyright (1450-1900)
www.copyrighthistory.org
Identifier: f_1759
Commentaire sur le contrat du Sieur d'Anville pour la Notice de l'Ancienne Gaule tirée des monumens romains...
Frédéric Rideau
Faculty of Law, University of Poitiers, France
Please cite as:
Rideau, F. (2008) ‘Commentary on the Sieur d'Anville's contract', in Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org
1. Titre complet
2. Résumé
3. Le principe de la rémunération contractuelle de l'auteur
4. La cession du manuscrit
5. Les enjeux liés à la correction du manuscrit
6. Références
1. Titre complet
Contrat entre un auteur, le sieur d'Anville, et ses libraires (Desaint, Saillant et Durant)
2. Résumé
Avant même que le travail de l'écrivain ne soit qualifié de propriété, la sphère contractuelle devait s'imposer au cours du XVIIe siècle comme un espace de liberté permettant à l'auteur d'affirmer concrètement ses intérêts dans la publication de son travail. Cet espace privé était d'autant plus important que les règlements sur la librairie étaient dévolus principalement, avant 1777, à l'organisation corporatiste du marché. Peu à peu, ce n'est plus l'auteur qui doit s'acquitter éventuellement d'une somme d'argent pour être publié, mais le libraire, qui accepte le principe de sa rémunération. Celle-ci constitue une source nouvelle de revenu pour un auteur s'émancipant de ses soutiens institutionnels traditionnels comme le mécénat. Comme en témoigne le contrat sans doute assez représentatif du Sieur d'Anville avec ses libraires, cette somme correspondait au transfert du manuscrit, plus généralement, au XVIIIe siècle, de l'œuvre et des principaux droits qui lui sont attachés. Après cette cession toutefois, c'est aussi par le biais du contrat que l'auteur pouvait conserver un accès à son travail, en particulier par le biais des corrections du manuscrit, pour la première ou une édition ultérieure. Ici encore, rien dans les règlements sur la librairie ne protégeait véritablement l'auteur.
3. Le principe de la rémunération de l'auteur
Au plus fort du "combat pour le droit d'auteur" entre les libraires de Paris et de province, et au cœur d'un marché régulé par une législation corporatiste et ambiguë,[1] la technique contractuelle devait a priori s'imposer comme un espace de responsabilité permettant à un auteur et au libraire de son choix de protéger au mieux leurs intérêts respectifs. En 1759, date du projet de traité entre le sieur d'Anville[2] et ses puissants interlocuteurs de la librairie parisienne[3], la sphère privée du contrat d'édition, la relation plus directe avec le public, étaient en effet censée mieux compenser, du moins pour les auteurs les plus renommés, le déclin du mécénat.[4]
Même si ne nous restent du XVIe et du XVIIe siècles que très peu de transactions conclues sous seing privé pour témoigner directement de la rémunération de l'auteur pour son travail, son principe semble acquis au XVIIe siècle. Gabriel Guéret dans sa Promenade de Saint-Cloud pouvait ainsi écrire en 1669, qu'on "ne voit quasi plus personne qui travaille pour sa propre gloire, et l'argent fait faire la plus grande partie de tous les livres que vous voyez".[5] Ce qui ne signifiait d'ailleurs pas à l'époque pas que le souhait de vivre de sa plume n'était plus suspecté de "roture".[6] L'auteur "professionnel" naissant était un être ambigu, l'examen des motifs qui le poussaient demeurait l'objet d'un examen minutieux. Pour Boileau, dans son passage si souvent évoqué du chant IV de l'Art Poétique (1674),[7] on peut, sans rougir, mériter par son labeur "un tribut légitime", mais l'on ne s'attache pas à l'art littéraire, sous peine d'être un "mercenaire", pour des raisons patrimoniales.[8] L'homme de lettres est naturellement, avant tout, écrivain pour le "bien public", pour la gloire, comme le rappela encore fermement Chevillier à la fin du XVIIe siècle. Bref, est suspecte la duplicité de l'auteur susceptible d'effectuer de "bonnes affaires" par le biais d'une activité aussi passionnelle :
"La vérité néanmoins nous oblige de dire que ce n'est point toûjours le Libraire qu'on doit accuser quand on achete un Livre cherement. Et ce n'est pas le seul Marchand qui se laisse aller à un esprit d'avarice. C'est aussi quelque fois celui qui a le mieux écrit contre ce vice ; je veux dire, que c'est quelquefois un Auteur trop intéressé à qui on doit s'en prendre ; & qui pour avoir tiré une somme considerable du Libraire, est cause qu'on ne peut avoir un Livre à un prix raisonnable ; conduite, à mon avis, peu digne d'un homme de Lettres, qui ne doit être animé quand il compose, que de la vûë d'un bien public. Le commerce qu'il fait de sa plume, & dans lequel il ne se propose que gain, rabaisse sa qualité à celle d'un Negotiant, & ce n'est plus qu'une ame commune, agitée d'une basse idée de gagner de l'argent."[9]
Dans la relation contractuelle, le libraire seul semble vraiment pouvoir assumer la vocation patrimoniale de son travail, par le moyen le plus évident de faire fructifier l'œuvre, c'est-à-dire sa reproduction exclusive.[10] La forte présomption du caractère noble, voire héroïque, de la création, devait par conséquent autoriser les libraires eux-mêmes, qu'ils soient de Paris ou de province, à dénoncer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle les intentions peu dignes de certains auteurs supposés trop vénaux. Ainsi en 1776, ceux de Lyon et de Rouen, dans leur dernier grand mémoire contre les monopoles de leurs homologues parisiens, pour qui l'homme "de génie qui entre dans la carrière pénible et honorable de la Littérature, peut avoir ces trois objets en vue ; d'éclairer ses semblables, d'éterniser sa réputation, et même de retirer quelque salaire de ses travaux".[11] Une hiérarchie des fins sans équivoque dont le juge Yates, en Angleterre, ne manquera pas de rappeler l'esprit, à la même époque, au cours de l'affaire Millar v. Taylor (uk_1769). [12]
Les gains des auteurs pour leur travail, réels dès le XVIIe siècle, pouvaient cependant varier "entre des extrêmes très éloignés". En ce qui concerne l'échelle générale des rémunérations, pour A. Viala, schématiquement, la première catégorie était notamment constituée par les auteurs bourgeois et les nobles, "pratiquant la littérature en amateurs" et qui ne touchaient aucune rémunération pour leur travail ; la seconde englobait les "besogneux" et les écrivains "de petite renommée", ou écrivant dans des genres peu vendeurs, et qui pouvaient espérer dès la deuxième moitié du XVIIe siècle 100 à 300 livres pour leur travail ; la troisième plus fréquente, impliquait de plus forte sommes, s'échelonnant de 300 à 1000 livres, indépendamment du thème de l'œuvre (un Racine "débutant" ayant pu obtenir 348 livres pour La Thébaïde) ; enfin, la dernière catégorie, qui concernait les auteurs et les œuvres les plus reconnus, c'est-à-dire dont "le succès auprès du public pouvait se retraduire aussi, pour l'écrivain, en des gains financiers importants" (Corneille, par exemple, reçut par exemple 2000 livres pour Attila).[13] La plupart du temps, ces sommes étaient forfaitaires, s'établissaient en fonction des prévisions de vente du nombre d'exemplaires de l'ouvrage, et pouvaient d'ailleurs même s'échelonner en fonction de la vitesse de celle-ci.[14] Quelques témoignages évoquent cependant une rétribution de l'auteur au pourcentage dès cette époque.[15] En réalité, il s'agit d'un mode de rémunération plus fréquent en matière de théâtre, en relation avec le succès de la représentation de l'œuvre (cf. f_1780).
A l'époque du contrat du sieur d'Anville, il reste de toute façon difficile de vivre de sa plume, sans le soutien d'un mécène, et les prix constatés dans les accords éditoriaux sont souvent médiocres, voire "avilissants", même si certains auteurs, comme Rousseau, ou Diderot par exemple, au fil de leur renommée grandissante, surent parfois mieux défendre leurs intérêts patrimoniaux. Voltaire ne reçut du libraire Prault que 1000 livres pour L'enfant prodigue, malgré une réputation qui laissait présager à son libraire un risque éditorial limité.[16] L'homme de lettres, dont les ambitions, comme on l'a observé, devaient rester pures, a pu même être tenu pour responsable de la stagnation de ces montants, voire même du maintien consécutif de l'opulence de certains libraires parisiens.[17] Dans le secret de la négociation contractuelle, rien n'est moins quantifiable. Il reste que de leur côté, les libraires ne se privèrent pas de stigmatiser les potentielles revendications vénales des écrivains, déjà nostalgiques, dans les années 1720, d'une époque "où ces célebres Auteurs qui ne visoient qu'à la gloire, ne se connoissoient point à l'art de succer un Libraire, et se contentoient d'un présent de Livres qu'ils recevoient comme une marque de sa reconnoissance et non comme une rétribution qu'ils exigeassent."[18]
Si comme outre-manche, les hommes n'étaient donc pas censés écrire pour de l'argent,[19] le principe d'une rémunération contractuellement, c'est-à-dire librement, choisie et donc assumée, pouvait être néanmoins appréhendée comme une manifestation de la souveraineté croissante de l'auteur. Ce dernier, dans l'idéal, ne devait désormais son succès ou sa légitimité qu'au public : c'est le public, non le patron ou l'appartenance institutionnelle qui "fixe le prix - matériel et symbolique -" de l'œuvre.[20] Le fait même qu'un contrat puisse être conclu entre l'écrivain et un indispensable libraire "professionnalisait" et "responsabilisait" peu à peu l'auteur.[21]
Cela étant, la liberté de négociation restait pour l'auteur relativement limitée, et la rémunération correspondait le plus souvent au transfert sans partage de l'œuvre.
4. La cession du manuscrit
Diderot rappelait en 1763 que les traités "en librairie" de l'époque se concluaient selon des usages anciens: "l'accord entre le libraire et l'auteur se faisait alors comme aujourd'hui : l'auteur appelait le libraire, et lui proposait son ouvrage; ils convenaient ensemble du prix, de la forme, et des autres conditions".[22] Sur fond de consensualisme dominant, l'échange des volontés paraissait donc on ne peut plus libéral.
Rappelons cependant que l'auteur ne pouvait pas faire commerce lui-même de ses propres ouvrages et devait, quelles que soient les modalités du contrat, s'en référer à la corporation des libraires et imprimeurs.[23] En réalité, maintenir les auteurs sous une intense pression contractuelle se manifestait sans doute, dans l'esprit de tout libraire, comme un principe légitime de survie économique, et les outils de "négociation", outre la stigmatisation de l'auteur vénal, étaient nombreux et puissants.[24]
Entre le sieur d'Anville, et ses libraires, le manuscrit fut cédé pour "quatre payements égaux". Mais il s'agissait bien en l'espèce d'une somme forfaitaire de 1200 livres, règle qui s'impose encore dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.[25] Cette somme correspondait elle-même très vraisemblablement, dans l'esprit des cocontractants, au transfert de la propriété de l'œuvre, le manuscrit original constituant, en quelque sorte, le titre et la preuve ultimes de cette cession par l'auteur. La protection ultérieure de l'édition de l'ouvrage par le biais d'un privilège restait certes indispensable contre la contrefaçon, mais elle pouvait s'apparenter véritablement, en particulier dans l'esprit du libraire parisien, et sous réserve des formalités liées à la censure, à une formalité quasi-automatique.[26] L'essentiel était par conséquent d'imposer à l'auteur que le manuscrit soit bien "cédé" et "transporté" dans le contrat "pour toujours", faisant ainsi entrer totalement l'œuvre dans le patrimoine du libraire.[27] Concrètement, une telle clause de perpétuité permettait ainsi au cessionnaire du manuscrit de ne pas être gêné, lors d'une demande de prorogation de son propre privilège, par une demande parallèle d'un concurrent, voire même de l'auteur lui-même ou de ses ayants-droit.[28] La durée théorique provisoire des privilèges contrastant avec de telles modalités contractuelles, c'est bien ainsi la cession du manuscrit qui, à travers ce type d'accord, s'imposait comme source de la propriété, indépendamment de l'acte tutélaire, quel qu'il soit, susceptible d'en garantir l'exercice. Précisons enfin, que la cession du manuscrit pouvait, dans certains cas, être accompagnée du transfert formel de l'exclusivité. En effet, si l'auteur avait obtenu le privilège en son nom, ce qui constituait souvent une marque de reconnaissance du pouvoir royal à l'égard de sa personne, il était le plus souvent censé également en rétrocéder les droits, avec le manuscrit, au libraire.[29]
De manière générale, le caractère souvent modeste, et forfaitaire, de la somme transmise à l'auteur pour un tel transfert de son ouvrage était justifié par le risque financier consubstantiel à l'édition:
"Il est vray que le Vulgaire qui n'examine les choses que superficiellement, s'imagine que comme l'objet d'un Libraire dans l'acquisition d'un manuscrit n'est autre chose que le profit qu'il espere tirer de la premiere Edition de l'Ouvrage, son droit se borne à la courte durée du premier Privilege qu'il obtient pour l'imprimer; mais ceux qui sont instruits de ce genre de commerce et qui jugent sainement les choses pensent bien differemment; ils sçavent au contraire qu'un Libraire qui acquiert un manuscrit, ne s'en chargeroit jamais s'il ne comptoit sur la proprieté permanente que l'auteur lui transmet, parce que de toutes les especes d'acquisitions qui font l'objet du commerce, il n'y en a point où il y ait plus de risque à courir, plus de dépense à faire, plus de revolutions à craindre, et dont le fond est une valeur plus incertaine dans l'évenement que celles ces Ouvrages litteraires."[30]
En somme, les bénéfices éventuels, en particulier sur les éditions subséquentes, constituaient la récompense exclusive de ce risque éditorial, ce que devaient encore confirmer les libraires de province dans les années 1770.[31]
Les libraires les moins scrupuleux avaient en outre la fâcheuse tendance à maquiller leur comptabilité, de sorte que l'ouvrage paraisse moins rentable. Le procédé leur permettait dès lors d'obtenir une protection supplémentaire de l'administration royale, ou par exemple, en matière contractuelle, de mieux faire pression sur la négociation du prix d'une cession totale d'un manuscrit après s'être chargé d'une vente à "compte d'auteur". L'abbé Blondel, au début du XVIIIe siècle, fustigea ces pratiques qu'il qualifia de "vexatoires", tant pour le public que pour l'auteur partie au contrat.[32] La longue affaire Luneau de Boisjermain, victime de ces manœuvres corporatistes, devait déboucher sur l'amère constatation que "depuis que l'art de l'Imprimerie est inventé, les Libraires ont toujours recueilli presque seuls le fruit des veilles de l'hommes studieux, qui éclaire et instruit ses semblables."[33] Ce qui est d'autant moins acceptable, s'insurgeait déjà Blondel, que "dans les bonnes régles, le Libraire est fait pour l'auteur & non pas l'auteur pour le libraire."[34]
Cette dépendance était enfin amplifiée par la nécessité, pour les jeunes auteurs ambitieux, de conclure un contrat avec un libraire de la capitale. Les libraires provinciaux, amers de ne pouvoir capter les éditions nouvelles les plus prometteuses, ou de pouvoir les faire vendre correctement à Paris, le reconnaissaient eux-mêmes ; la renommée se faisait en effet à Paris, sous la dépendance des réseaux corporatistes de la capitale:
"L'Auteur s'adressera-t-il aux Libraires des Provinces ? Mais ceux-ci ne peuvent donner cours qu'aux Livres déja connus et recherchés; c'est par la Capitale seule que la voie de la gloire et de la célébrité peut s'ouvrir; les Libraires de Paris ne l'ignorent pas : aussi tout Livre nouveau imprimé en Province est-il proscrit par eux; ils se refusent à les vendre comme ils se refusent à vendre les Ouvrages d'Auteur, ainsi qu'ils ont coutume de s'exprimer."[35]
Dans la mesure où la cession pleine et entière du manuscrit s'imposait le plus souvent, se posait par conséquent la question pour l'auteur, par le biais de son contrat, d'en compenser les effets, c'est-à-dire d'organiser au mieux la possibilité de conserver malgré tout un lien avec son ouvrage, et notamment la possibilité d'améliorer son ouvrages, ou d'en contrôler les éventuelles modifications.
5. Les enjeux liés à la correction du manuscrit
De manière assez classique également, d'Anville s'engageait "à corriger deux épreuves", tout en se réservant de manière explicite "la faculté de faire des corrections et augmentations dans une édition suivante". Il semblerait que les libraires se soient souvent conformés à leurs engagements de laisser l'écrivain modifier, améliorer, son travail, même en l'absence de mentions contractuelles sur ce point. Il existait indiscutablement une convergence des intérêts de l'auteur et du libraire qui explique peut-être que peu d'affaires ne nous soient parvenues à ce sujet:[36] en ce qui concerne le libraire, la logique économique de l'entreprise éditoriale, et une édition corrigée et augmentée plus rentable, outre le fait qu'elle était plus susceptible de se voir protéger officiellement pour cette raison par une prorogation de privilège.[37] Les intérêts de l'auteur était plus complexes, sans aucun doute: certes de nouveaux honoraires pour l'exclusivité de ses corrections, révisions ou augmentations, pouvaient être négociés, en particulier dans l'optique d'une nouvelle édition. Parallèlement, étaient également en cause des intérêts moins pécuniaires, relatifs au lien que l'auteur conserve avec son travail, à sa réputation, et justifiant en principe son l'accès ultime à son travail avant la publication, voire même sa capacité à en contrôler l'intégrité en empêchant toute modification sans son consentement.[38] En dehors de la sphère contractuelle, l'auteur n'avait en effet que peu de garanties contre un libraire indélicat ou peu scrupuleux, comme en témoigne par exemple les relations de Diderot avec son libraire Le Breton.[39]
Parfois, en effet, les intérêts de chacun pouvaient ne pas coïncider. Dans une affaire opposant, dans les années 1720, le sieur d'Ancour à la veuve de Ribou, la question fut de savoir, dans le cas d'une première édition qui s'était mal écoulée et d'une prorogation consécutive du privilège en faveur du libraire, "si un Auteur qui a vendu ses Ouvrages" est en droit de les reprendre afin d'améliorer son ouvrage. Pour cela, l'auteur devait "demander que cette continuation de Privilege soit révoquée et annulée", car pour le sieur d'Ancour, si les auteurs n'avaient pas "cette liberté de corriger ses Ouvrages ils ne parviendroient pas à la perfection où il peut les porter...".[40] L'argument de l'écrivain était bien "extra-patrimonial", mais suspecté de vouloir faire fructifier une nouvelle édition à son seul profit, Ribou lui fit répondre qu'un "Auteur qui a vendu ses Ouvrages à un Libraire n'est point en droit de lui reprendre sous prétexte de corrections ou augmentations, d'autant plus que ce prétexte seroit souvent un faux prétexte, dont un Auteur de mauvaise fois se serviroit pour évincer le Libraire".[41] Certains auteurs ont d'ailleurs pu mettre l'accent sur la dimension négative du contrat d'édition, en particulier au XVIIe siècle. En effet, plus qu'une cession par l'auteur de ses droits sur sa création, celui-ci se serait engagé pour une certaine durée à ne pas en gêner la publication; ce qui pouvait être le cas en communiquant par exemple un manuscrit revu quelques années plus tard à un libraire concurrent.[42] Ce type de confrontation, plutôt rare, pouvait expliquer en partie les stipulations contractuelles spécifiées à l'article n°7 du contrat entre d'Anville et ses libraires et la nécessité de se réserver expressément la correction de son ouvrage pour une seconde édition.
Dans la deuxième moitié du 18e siècle, le principe de la rémunération de l'auteur par une somme forfaitaire contre la cession pour toujours du manuscrit original constituait donc la règle. Même rudimentaire, la fixation des modalités de ces obligations réciproques était pourtant censée affirmer, du moins en théorie, un espace de liberté et de responsabilité pour l'auteur, comme devait le défendre brillamment l'avocat Linguet en 1777. En pratique cependant, les intérêts de l'auteur ne semblaient pouvoir s'imposer, et être respectés, que s'ils étaient compatibles avec l'organisation corporatiste du marché littéraire, en particulier dans le cadre de l'édition parisienne.
6. Références
Lindenbaum, P., Milton's contract, in M. Woodmansee et P. Jaszi, The Construction of authorship : textual appropriation in law and literature (Durham and London, Duke University Press : 1994)
Pellisson, M., Les hommes de lettres au XVIIIe siècle (Genève : Slatkine reprints, 1970 - 1er éd. Paris, 1911)
Rault, J., Le contrat d'édition en droit français, Thèse, Paris, 1927
Saunders, D., Authorship and copyright (London : New-York, Routledge, 1992)
Viala, A., La naissance de l'écrivain (Paris : Les Editions de Minuit, 1985)
Walter, E., "Les auteurs et le champ littéraire", in Histoire de l'édition française, sous direction de Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Tome II (Paris : Fayard, 1990)
[1] Le conflit opposant Luneau de Boisjermain et les libraires de Paris (voir cette affaire et son commentaire - f_1770) en témoigne.
[2] Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville est né à Paris en 1697. Géographe du roi à 22 ans, et auteur de 211 cartes (ou plans) et de plus de 70 ouvrages et mémoire imprimés (portant sur des sujets techniques, comme la méthodologie des levés pour la construction de cartes de détails, divers travaux de géographie "historique" et sur les mesures anciennes...)
[3] La maison Desaint, en particulier, dont la veuve se fera connaître à plusieurs reprises par son action permanente pour la sauvegarde de ses intérêts et les "recherches les plus scandaleuses et les plus indécentes" contre ses collègues de province (Mss. Fr. 22073, n° 144, fol. 329). La veuve Desaint fera partie de ces libraires parisiens qui s'opposeront de manière virulente à Luneau de Boisjermain. Ce traité est également cité par Maurice Pellisson, Les hommes de lettres au XVIIIe siècle (Genève : Slatkine reprints, 1970 - 1er éd. Paris, 1911), 89 et rapporté page 297.
[4] Sur le mécénat, le mécénat "d'Etat" (et le clientélisme) voir Alain Viala, La naissance de l'écrivain (Paris : Les Editions de Minuit, 1985), 54 et s et également Eric Walter, "Les auteurs et le champ littéraire", in Histoire de l'édition française, sous direction de Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Tome II (Paris : Fayard, 1990), 499 et s. (page 503 sur le mécénat).
[5] Cité par Pellisson, 81.
[6] Charles-Augustin Renouard, Traité des droits d'auteur dans la littérature, les sciences et les Beaux-Arts, tome 1 (Paris : Jules Renouard et Cie, 1838),146 : "Quelque chose d'humble, et qui sentait la roture, imprimait aux habitudes de négoce un caractère d'infériorité qui ne laissait pas un écrivain sans rougeur lorsqu'il songeait à vivre du produit de ses ouvrages."
[7] "Je sais qu'un noble esprit peut, sans honte et sans crime,
Tirer de son travail un tribut légitime;
Mais je ne puis souffrir ces auteurs renommés,
Qui, dégoutés de gloire et d'argent affamés,
Mettent leur Appollon aux gages d'un libraire,
Et font, d'un art divin, un métier mercenaire." In Art Poétique, ch. IV, v. 127-132.
[8] Voir par exemple le mot de Diderot, dans lettre à sa sœur, à la fin d'une vie de littérature, le 25 novembre 1778 : "Je me soucie de l'argent comme de la boue." In Diderot : Sur le vif (lettres réunies et présentées par Jean Varloot) (Paris : Hermann éd., 1994), 160.
[9] A. Chevillier, L'origine de l'imprimerie de Paris. Dissertation historique et critique (Paris: Chez Jean de Laulne, 1694), 380-381.
[10] Ce qui a sans doute entraîné la qualification du droit exclusif reconnu par la loi d'Anne de droit d'éditeur (publisher's right), par un auteur comme Patterson : Lyman Ray Patterson, Copyright in Historical Perspective (Nashville : Vanderbilt University Press, 1968).
[11] De même Condorcet (cf f_1776a). A l'opposé de cette opinion se situe notamment Linguet, dès les années 1770 : la noblesse, pour l'auteur, c'est d'être libre de réclamer le tribut d'un ouvrage honorable (voir en particulier f_1777b).
[12] Sur cette affaire essentielle de l'histoire du copyright anglais, voir uk_1769.
[13] Viala, 107 et 108. Pour une analyse plus détaillée, en particulier sur la hiérarchie des genres, leur mode selon les époques, voir p. 109 et s. Le principe d'une rémunération était également acquis en Angleterre, à la même époque.
[14] Viala, 111. Cet auteur se risque à une estimation de 6 à 8 % du revenu "escompté" sur la vente du premier ouvrage, tout en reconnaissant que la seconde édition, éventuelle, n'était pas prise en compte dans ce savant calcul.
[15] Ibid. : Scarron dans le Roman Comique.
[16]V. Pellisson, 86 et s. Il est sûr en tout cas que même à la fin du XVIIe siècle, par rapport au niveau de vie de l'époque, même un écrivain à "succès" "ne faisait pas fortune grâce à ses droits d'auteur ; il pouvait en vivre, mais sur un pied médiocre..." (Viala, 113, qui tient cependant à nuancer, en rappelant que le statut de l'écrivain, encore aujourd'hui, sur ce plan, "reste encore incomplet").
[17] V. par exemple Marie-Claude Dock, Contribution historique à l'étude du droit d'auteur, LGDJ, Paris, 1963, 84, ou J. Rault, Le contrat d'édition en droit français, Thèse, Paris, 1927, 11. C'est également ce que laisse entendre l'avocat Linguet dans son mémoire de 1777, bien que son argumentation se fonde surtout sur une critique acerbe de la soumission au pouvoir des "encyclopédistes".
[18] Mémoire pour la veuve de Pierre Ribou, Libraire à Paris, Mss. Fr. 22072, n°60, fol. 270.
[19] H. S. Bennett, English Books and Readers 1603-1640: Being a Study in the History of the Book Trade in The Reigns of James I and Charles I, Cambridge: Cambridge University Press, 1970, 3
[20] Bernard Edelman, Le sacre de l'auteur (Paris : Ed. du Seuil, 2004), 133. Cf. également, du même auteur, l'épisode de la fameuse querelle du Cid (129 et s). Enfin, sur ce rapport entre le public et l'auteur, voir également notre article sur le mémoire de l'avocat Linguet (f_1777c), à la suite des arrêts du 30 août 1777 (f_1777a).
[21] P. Lindenbaum, Milton's contract, in M. Woodmansee et P. Jaszi, The Construction of authorship : textual appropriation in law and literature (Durham and London, Duke University Press : 1994), 175 et s. Lindenbaum rappelle en effet que ce contrat est en soi est plus importante que la valeur de la somme elle-même consentie à Milton : For that alone we see the an author who is fully acknowledging the condition of authorship, viewing himself as the possessor of property that gives him definite rights.
[22] Diderot, Lettre sur le commerce de la librairie, Paris, Librairie Fontaine, 1984, 38.
[23] Ce point fut âprement débattu au cours de l'affaire Luneau de Boisjermain (f_1770). V. également sur la question les regrets de Malesherbes, p. 161-162. Il faudra attendre les arrêts du 30 août 1777 (f_1777a) pour que cette interdiction soit levée.
[24] Lamoignon de Malesherbes, Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la presse (Paris:Imprimerie Nationale, 1994).
[25] Comme d'ailleurs en Angleterre : cf. A. S. Collins, Authorship in the days of Johnson, being a study of the relation between author, patron, publishers and public, 1726-1780 (London : Robert Holden and Co. LTD, 1927), ainsi, que, du meme auteur, The Profession of Letter: A Study of the Relation of Author to Patron, Publisher, and Public, 1780-1832 (London : George Routledge and Sons, 1928). Outre la rémunération du manuscrit, l'auteur était d'ailleurs susceptible de recevoir des exemplaires de son ouvrage, en l'espèce pour le sieur d'Anville, une douzaine brochés (cf. article 3°, ou encore des exemplaires pouvant être acquis "au prix de province").
[26] Une reconnaissance du transfert librement consenti de cette propriété ou encore un "acte authentique" de cette vente, comme dirait Louis d'Héricourt, avocat des libraires parisiens en 1725 (cf. 1725b). Pour un tableau très pratique de la procédure d'obtention du privilège, on pourra consulter le Manuel de l'auteur et du libraire (Paris : Chez la Veuve Duchesne, 1777).
[27] Dans son projet de traité avec Duchesne pour l'Emile (rapporté par Pellisson, p. 297) Rousseau stipule qu'il transfère un manuscrit de sa composition à son Libraire, afin que celui-ci puisse en jouir, ainsi que ses ayants cause, "comme de chose qui leur appartient en propriété", pour une somme de 6000 livres. Le privilège suit en quelque sorte comme un accessoire la cession du manuscrit même s'il est lui-même formellement limité dans le temps par le roi ou par toute autre institution, comme en témoignent les cessions de privilèges obtenus par les auteurs : plusieurs exemples, comme la cession, de l'Abbé Guyon le 25 septembre 1743 "pour toujours" de son "droit au présent privilège...", à propos d'un manuscrit intitulé Histoire des Indes Orientales, ou encore celle de Durant de Maillane au libraire Bruyset d'un privilège obtenu en 1767 pour "ses Institutes de Droit Canonique, aux fins d'en jouir pour toujours, à perpétuité...". Ces exemples sont rapportés par Paul Olagnier, Le droit d'auteur, tome 1er, Paris, LGDJ, 1934, p. 94 et 95.
[28] Pour une affaire traitant plus précisément de cette question, voir les contestations des petites-filles de La Fontaine (f_1761).
[29] Sur la question de la vente par l'auteur de ses propres ouvrages, voir l'affaire Luneau de Boisjermain (f_1770) et son commentaire. Pour les privilèges conférés à l'auteur, cf. le privilège de Eloy d'Amerval (f_1507).
[30] Mss. Fr. 22072, n°69, fol. 296: "Mémoire pour Guillaume Desprez, et Jean Desessartz, Libraires et Imprimeurs à Paris, Demandeurs: Contre François Emeri, Claude-Martin Saugrain, et Pierre-Alexandre Martin, Libraires de la même ville, Défendeurs; Et encore contre Dom Guillemin, Prêtre, Religieux Benediction de la Congregation de saint Vannes, Intervenant." Ce mémoire n'est pas daté, mais il fut probablement rédigé et diffusé dans les années 1725-1730. Dans le même sens, pour la veuve du puissant libraire parisien Ribou, il n'est certes pas "juste" qu'un auteur "soit privé des fruits de ses travaux". Mais il doit comprendre inversement qu'il n'est pas plus "juste que L'auteur ruine son Libraire, et que il lui a vendu ses Ouvrages et qu'il en a été payé, il n'est pas en droit de les lui reprendre" (Mss. Fr. 22072, n°69, fol. 296).
[31] "... on ne peut juger du mérite d'un livre, ou du moins du cours qu'il aura, qu'après sa publicité.... D'après cela, il est certain que tout libraire qui achète un manuscrit ne peut faire son calcul que sur le produit de la première édition, et qu'il y joint au frais d'impression le prix du manuscrit et son bénéfice qui est toujours porté fort haut. S'il arrive qu'il en fasse une seconde, une troisième édition ou davantage, c'est un bénéfice de surcroît dont le libraire jouit seul, et auquel il n'a aucun égard dans l'achat du manuscrit." (Mss. Fr. 22073, n° 141, fol. 317).
[32] Cf. f_1725a (Mémoire sur les vexations...).
[33] Charles-Georges de Fenouillot de Falbaire, Avis au gens de Lettres (Liège, 1769), 1 (Mss. Fr. 22069, n° 9 - f_1769).
[34] P.-J. Blondel, 29, qui ajoute : "Celui-ci [le libraire] est un trafiquant qui débite, l'Auteur est un homme qui pense & qui invente".
[35] Mss. Fr. 22073, n° 144, fol. 329. Sur la question de la vente à compte d'auteur, voir affaire Luneau de Boisjermain, f_1770.
[36] De son côté, le libraire pouvait d'ailleurs expressément se réserver l'exclusivité des corrections. Cf, par exemple, pour l'Angleterre, L. R. Patterson (Copyright in Historical Perspective, Nashville, Vanderbilt University Press, p. 395), Thomson, en 1729, "did assign to Millar, his executors, administrators and assigns, the true copies of the said tragedy and poem, and the sole and exclusive right and property of printing the said copies for his and their sole use and benefit, and also all benefit of all additions, corrections, and amendments which should be afterwards made in the said copies."
[37] Sur cette question, voir l'affaire Josse v. Malassis (f_1665).
[38] Sur ce point, et le caractère hétérogène des intérêts en jeu dans le contrat d'édition, voir l'intéressante réflexion de L. R. Patterson, 70 et s. sur les " inchoate rights" qui seraient révélés dans ce type d'échanges entre libraires et auteurs.
[39] Au sujet de la publication de l'Encyclopédie, et même de la publication de la Lettre sur le commerce de la librairie, voir f_1763.
[40] Mss. Fr. 22072, n°69, fol. 270. Nous ne sommes pas hélas parvenus à retrouver le contrat conclu entre le sieur d'Ancour et la veuve Ribou.
[41] Ibid.
[42] Sur ce point, voir en effet D. Saunders, Authorship and copyright (London : New-York, Routledge, 1992), 49.